Isabelle Eberhardt est une figure singulière et libre du tournant du XIXe siècle, dont la vie brève et intense défie les normes sociales, religieuses et littéraires de son époque. Née à Genève dans une famille marginale et cosmopolite, elle choisit très tôt l’errance, l’écriture et le travestissement pour explorer l’ailleurs, particulièrement l’Algérie coloniale, qu’elle adopte comme patrie d’adoption.
Isabelle Eberhardt naît le 17 février 1877 à Genève, à la villa Fendt dans le quartier des Grottes. Elle est la fille illégitime de réfugiés russes: Natalia de Moerder née Eberhardt, épouse d’un général russe et issue d’une famille noble, et Alexandre Trophimovsky, dit «Vava», précepteur et libre penseur. Ils quittent rapidement les Grottes pour habiter à Vernier, à la «Villa Neuve».
Isabelle grandit dans un environnement atypique. Au sein d’une famille recomposée, elle partage son enfance avec ses demi-frères et sœurs dans une atmosphère cosmopolite où se mêlent russe, français, arabe, allemand, grec et latin. Éduquée d’abord à la maison par Vava, puis à l’école secondaire, elle développe très tôt une soif insatiable de connaissances, nourrie par les nombreuses langues, lectures et discussions intellectuelles qui peuplent son quotidien.
Dans le quartier de Vernier, plusieurs lieux gardent la trace du passage d’Isabelle Eberhardt et de sa famille. La «Villa Neuve», que les Eberhardt-Trophimovsky habitent dès 1879 est bientôt surnommée «Casa Bamba» par les habitants (un nom restée dans l’odonymie locale). Parfois, on l’appelle aussi la «Villa tropicale» en raison des serres exotiques qu’y a fait construire Alexandre Trophimovsky.
Le quartier entier tire son nom d’un étang présent aux abords de la Casa Bamba, peuplé de tritons, dont la forme singulière valut au bassin le surnom de «Mer Caspienne». Cette appellation pittoresque, rapportée par plusieurs sources locales, évoque la nostalgie supposée de Trophimovsky pour la Russie. Ce lieu, toujours visible aujourd’hui sous le nom d’étang des tritons, fut le théâtre silencieux de l’imaginaire d’Isabelle. Il est encore évoqué de nos jours grâce au chemin de l’Étang, et à tout le quartier qui porte encore ce nom, au cœur duquel on retrouve aussi les allées des Grenouilles, des Nénuphars et des Têtards…

Très jeune, Isabelle est fascinée par l’ailleurs, le voyage, et l’Orient. Lorsque ses frères s’engagent dans la Légion étrangère, notamment en Algérie, elle découvre par leurs récits un monde qui deviendra bientôt le sien. Elle apprend l’arabe, le kabyle, se met au dessin pour croquer ses impressions de voyage, et commence à écrire sous un pseudonyme masculin, Nicolas Podolinsky. À 18 ans, elle publie ses premières nouvelles.
En 1897, Isabelle embarque pour son premier voyage en Algérie, en compagnie de sa mère. Elles se convertissent à l’islam, et Isabelle adopte l’identité masculine de «Mahmoud Saadi». Ce séjour marque un tournant. L’écrivaine se détache du modèle occidental et s’immerge dans les sociétés musulmanes d’Afrique du Nord. Après la mort de sa mère, le suicide de son frère Wladimir et la disparition de Vava, elle entame une errance marquée par la douleur, l’écriture et les déguisements. Isabelle alterne les identités, les pseudonymes, les genres, brouillant volontairement les frontières.

Travestie en homme, Isabelle sillonne seule les routes du Sahara, côtoie les caravanes et les bédouins. Son mode de vie nomade, marginal et libre choque autant qu’il fascine. Elle s’enivre, fume, dort à la belle étoile. Elle publie des récits de voyage dans des journaux, collabore avec L’Akhbar dirigé par Victor Barrucand et développe un style de littérature inédit, sans préjugés, adoptant le point de vue des colonisés. Isabelle se fait aussi la défenseuse des fellahs et dénonce les abus de la colonisation française, notamment la torture.
En 1901, elle est victime d’une tentative d’assassinat à Béhina. Les autorités coloniales, dérangées par son indépendance, sa liaison avec Slimène Ehnni (un officier musulman dans l’armée française), ses critiques politiques et son refus de se conformer, la bannissent d’Algérie. Elle se réfugie à Marseille, voyage clandestinement, et finit par obtenir l’autorisation d’épouser Slimène. Revenue en Algérie, elle poursuit ses reportages et se lie avec des figures comme le colonel Lyautey, futur maréchal de France. En 1903, elle devient la première femme reportrice de guerre, couvrant un conflit frontalier entre le Maroc et l’Algérie.

Le 21 octobre 1904, Isabelle Eberhardt meurt tragiquement dans une inondation à Aïn-Sefra, à seulement 27 ans. Lyautey, bouleversé, fait rechercher ses manuscrits dans les décombres. Victor Barrucand publie une partie de son œuvre posthume. Bien qu’elle n’ait pas connu la reconnaissance de son vivant, Isabelle laisse derrière elle des écrits puissants, marqués par sa vie d’errance. Elle est ainsi l’une des premières femmes à s’imposer dans l’espace public masculin de la littérature de voyage, tout en dénonçant les injustices de son temps.
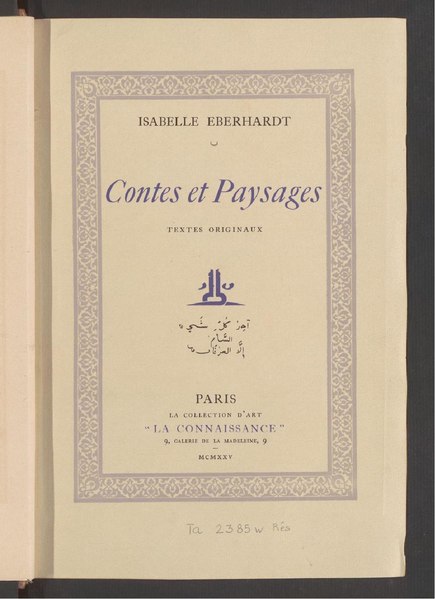
Vous voulez lire une autre histoire des noms de rues?
« Est-ce vrai que l’étang qui a donné son nom au quartier de l’Etang à Vernier a été créé au début du 20e s. par un ancien officier tsariste ? ». Interroge, 02.08.2023. En ligne ici.
Ghania Adamo. « Isabelle Eberhardt, pionnière des écrivaines voyageuses suisses ». Swissinfo, 21.02.2019. En ligne ici.
Sandrine Vuilleumier. « La plume nomade ». Blog du musée national suisse, 26.04.2021. En ligne ici.
Site des noms géographiques du canton de Genève.
Images 1 et 2. Photographie de l’autrice.
Images 3 à 5. Domaine public, Wikimedia Commons.